

1°) Définition:
Le son est une onde dite "de compression". Dans de l'air immobile, la pression est la même partout, et l'air a partout la même densité. Par contre, un son est une perturbation de la pression de l'air. Lorsqu'un son traverse l'air, on peut observer des zones où la pression de l'air est plus importante que lorsqu'il n'y a pas de son. Dans ces zones, l'air est plus comprimé. On observe aussi des zones où l'air est plus dilaté, dans des zones de dépression. Ces perturbations de la pression de l'air se déplacent : c'est l'onde sonore.

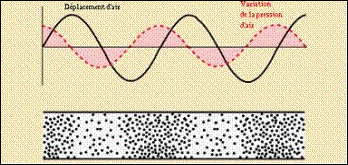
Lors de l’une de nos expériences, nous avons démontrer de façon simple, que le son est une onde. Pour cela, nous avons relié un micro sur un oscilloscope afin de capter le son émis par un diapason (Ce dernier émettant un son dit : pur. Dans notre cas, c’était le « la 440 »). Ainsi nous avons observé une courbe sinusoïdale, typique des ondes. Ainsi nous somme certains que le son est une onde.
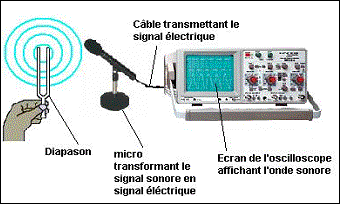
2°) La nature du son
Il existe trois facteurs qui caractérisent le son.
Ce sont : sa fréquence ou hauteur, son amplitude aussi bien appelé intensité et enfin son timbre.
Nous ne traiterons que les deux premiers facteurs car le timbre n’intervient que très peu dans les différences de perception entre les individus. Il reste donc négligeable dans les conditions de notre TPE malgré le fait que ce soit un facteur tout à fait intéressant à traiter.
* La fréquence (f en Hertz, écrit Hz) est le nombre de période de l’onde sonore en une seconde. C’est donc l’inverse de la période.
Un phénomène est dit périodique quand au bout d’un intervalle de temps donné, il se répète identique a lui-même. Ainsi la période (T en seconde, écrit s) est le temps mis par ce phénomène pour se répéter
Les deux formules qui permettent de calculer la fréquence f en fonction de la période T et réciproquement sont :
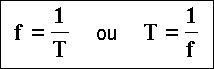
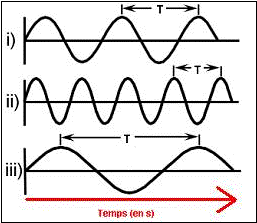
Observons des périodes plus ou moins longues.
Nous voyons bien que ii) a la période la plus courte, ainsi, d’après la formule ci-dessus, sa fréquence est élevé; c’est donc une note aiguë.
A contrario, si l’on regarde iii), on devine que c’est une note grave.
*L’amplitude : Pour le son, l’amplitude correspond à l’écart de pression maximale entre ce que l’on appelle les ventres de pression et ceux de dépression. Sur l’image ci dessous, on ne peut identifier lesquels sont des ventres de pression et/ou de dépression.
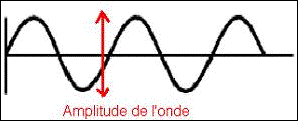
L’intensité d’un son, appelé aussi volume est en relation directe avec l’amplitude du son. Ainsi, plus un son est fort, plus son intensité est élevée et plus l’amplitude est grande. Cette intensité se mesure en décibel (dB). Mais attention, la notion de niveau sonore ne donne qu'une vague idée de la sensation perçue, car il faut prendre en compte la sensibilité de l'oreille, qui varie principalement selon la fréquence du son (l'oreille est moins sensible aux basses fréquences).
Cette intensité est mesurable grâce à un sonomètre qui donne une valeur en décibel.
3°) La propagation du son
Comme nous l’avons dit auparavant, le son se déplace grâce aux particules présentes dans l’air et dans la matière. Ainsi, le son ne peut se propager dans le vide total.
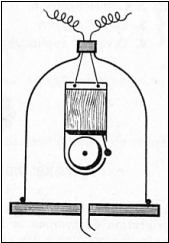
L’expérience suivante démontre que lorsque l’on prive la source sonore de l’air qui l’entoure, on remarque que le son ne se propage plus.
On a disposé un réveil sous la cloche d’une pompe à vide. Le réveil est suspendu pour éviter le maximum de contact avec un matériau susceptible de transmettre le son. Lorsque le vide est effectué, on ne perçoit plus le bruit du réveil. Donc le son a bien besoin de molécules d’air ou de quelques autres matériaux pour se propager.
Cette expérience a été réalisée et filmée sur vidéo mais malheureusement le résultat est moins probant du fait de la difficulté à effectuer le vide total .
On peut aussi évoquer la célérité du son. La célérité, c’est la vitesse du son, elle dépend de plusieurs facteurs qui sont la nature, la température, la pression, la masse volumique ou la densité du milieu.
La densité joue le rôle le plus important : dans un gaz, sa vitesse est plus faible que dans un liquide. Par exemple, le son se propage approximativement à 340 m/s dans l'air à 15°C alors que sa célérité atteint à 1 435 m/s dans l'eau douce. Voici donc la célérité du son dans différents matériaux pour une même température de 20°C et à la pression atmosphérique.
Voici donc la célérité du son dans différents matériaux pour une même température de 20°C et à la pression atmosphérique.
Matériaux |
Célérité en m.s-1 |
Air |
340 |
Plomb |
1200 |
Eau douce |
1440 |
Béton |
3100 |
Glace |
3200 |
Hêtre |
3300 |
Acier |
5200 |
Verre |
5300 |
Granit |
6200 |
D’ailleurs l’air étant proche du gaz parfait, d’après l’équation suivante :
Avec :
-(gamma) représentant le coefficient adiabatique (coefficient utilisé en thermodynamique) qui correspond à la variation de la pression sur la variation du volume de la matière traversée par le son. On peut considérer que ce nombre est une constante qui est environ égale à 1.41.
-R, la constante des gaz parfaits étant égale à 8,314 472 J.kg-1.K-1
-T étant la température du milieu en Kelvin
-M est la masse molaire de la matière environnante.
Nous avons calculé la célérité du son pour la température pour 0°C (c’est à dire 273.15 K) et l’on trouve : 332m.s-1
Ainsi la vitesse du son ne dépend que très peu de la température.